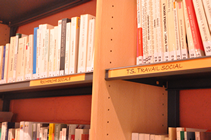[article]
| Titre : |
Former à l’intervention sociale : Comment pensent (et font penser) les instituts de formation à l’intervention sociale et au travail social professionnels [Dossier] |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Yves Lacascade, Directeur de publication, rédacteur en chef |
| Année de publication : |
2023 |
| Article en page(s) : |
p. 7-126 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
TS
Action sociale # Formation # Formation professionnelle # Travailleurs sociaux:Travailleurs sociaux -- Formation
|
| Résumé : |
"Le dossier que nous proposons aujourd’hui est, comme le titre et le sous-titre de ce numéro l’indiquent, consacré à la formation des travailleurs et des intervenants sociaux professionnels. Son objectif est à la fois de proposer des pistes d’analyse critique de cette formation, dans ses principes comme dans ses modalités pratiques, de comprendre comment elle évolue et sera amenée à évoluer dans les années qui viennent, mais également d’éclairer d’autres aspects du fonctionnement des instituts de formation et tout particulièrement la façon dont les activités de recherche s’y développent et les questions que pose ce positionnement, sinon nouveau, du moins de plus en plus clairement assumé. Les neuf articles qui le composent peuvent être regroupés en quatre sous-ensembles relativement homogènes. Dans le premier d’entre eux, Patrick Lechaux montre comment le système de formation des travailleurs sociaux est né, au début du siècle dernier, du croisement de ce qu’il nomme deux « matrices épistémiques » : la matrice « étatico-associativo-corporative », d’une part et la matrice d’opposition de genres entre université humboldtienne et écoles professionnelles de métier, d’autre part. Pour le dire autrement, dans un contexte où s’imposait la nécessité de l’émergence d’un véritable « État social », le choix a été fait de développer la formation de nouvelles catégories d’acteurs sociaux via des écoles professionnelles de métier, à distance à la fois du modèle universitaire allemand qui s’imposait alors en Europe et de celui de « l’université utile » qui dominait outre-Atlantique. Selon l’auteur, une nouvelle matrice se dessine cependant au tournant des années 2000 qui rend possible l’émergence d’une nouvelle conception de la formation professionnelle qui ne se fasse plus sans le monde académique, mais dans un dialogue constant avec lui, favorisant l’apparition de nouvelles « configurations curriculaires » qui sont selon lui appelées à se développer et dont il examine deux premiers exemples, à ses yeux particulièrement significatifs. Au travers de ceux-ci, c’est également une nouvelle conception de la recherche et de son lien avec la formation qui se fait jour. Cette même recherche, du moins telle qu’elle se développe dans certains instituts de formation ayant fait le choix de se doter de laboratoires ou de « services recherche », est au cœur de l’article de Maëlle Moalic-Minnaert. Celle-ci met à profit son passage durant une année, à l’issue de son parcours doctoral, dans l’un de ces services, pour « documenter la dissonance entre le projet affiché » par celui-ci de devenir un « véritable » laboratoire de recherche et sa capacité à y parvenir, compte tenu notamment des contraintes institutionnelles et partenariales auxquelles il doit faire face. Dans les faits, les démarches évaluatives constituent une part importante de son activité, tout comme celles consistant à « accompagner les collectivités territoriales », les pratiques de collecte des données n’étant par ailleurs pas toujours conformes aux canons de l’exigence académique. D’où le constat de l’autrice selon lequel « en dépit de son aspiration à privilégier la recherche, le service reste “à mi-chemin entre une logique de savoirs et une logique d’actions” ». L’une des causes de cette situation étant, en plus des exigences de rentabilité et de productivité qui pèsent sur le service, à chercher également du côté des modes de socialisation des docteurs et des doctorants qui y travaillent et qui se sont pour partie réalisés à distance du monde académique. Leur expérience antérieure de travailleurs sociaux pouvant cependant constituer un atout lorsqu’il s’agit de conduire des recherches de type collaboratif." |
| En ligne : |
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2022-2.htm |
| Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37994 |
in Pensée plurielle > 56 (2022) . - p. 7-126
[article] Former à l’intervention sociale : Comment pensent (et font penser) les instituts de formation à l’intervention sociale et au travail social professionnels [Dossier] [texte imprimé] / Yves Lacascade, Directeur de publication, rédacteur en chef . - 2023 . - p. 7-126. Langues : Français ( fre) in Pensée plurielle > 56 (2022) . - p. 7-126
| Catégories : |
TS
Action sociale # Formation # Formation professionnelle # Travailleurs sociaux:Travailleurs sociaux -- Formation
|
| Résumé : |
"Le dossier que nous proposons aujourd’hui est, comme le titre et le sous-titre de ce numéro l’indiquent, consacré à la formation des travailleurs et des intervenants sociaux professionnels. Son objectif est à la fois de proposer des pistes d’analyse critique de cette formation, dans ses principes comme dans ses modalités pratiques, de comprendre comment elle évolue et sera amenée à évoluer dans les années qui viennent, mais également d’éclairer d’autres aspects du fonctionnement des instituts de formation et tout particulièrement la façon dont les activités de recherche s’y développent et les questions que pose ce positionnement, sinon nouveau, du moins de plus en plus clairement assumé. Les neuf articles qui le composent peuvent être regroupés en quatre sous-ensembles relativement homogènes. Dans le premier d’entre eux, Patrick Lechaux montre comment le système de formation des travailleurs sociaux est né, au début du siècle dernier, du croisement de ce qu’il nomme deux « matrices épistémiques » : la matrice « étatico-associativo-corporative », d’une part et la matrice d’opposition de genres entre université humboldtienne et écoles professionnelles de métier, d’autre part. Pour le dire autrement, dans un contexte où s’imposait la nécessité de l’émergence d’un véritable « État social », le choix a été fait de développer la formation de nouvelles catégories d’acteurs sociaux via des écoles professionnelles de métier, à distance à la fois du modèle universitaire allemand qui s’imposait alors en Europe et de celui de « l’université utile » qui dominait outre-Atlantique. Selon l’auteur, une nouvelle matrice se dessine cependant au tournant des années 2000 qui rend possible l’émergence d’une nouvelle conception de la formation professionnelle qui ne se fasse plus sans le monde académique, mais dans un dialogue constant avec lui, favorisant l’apparition de nouvelles « configurations curriculaires » qui sont selon lui appelées à se développer et dont il examine deux premiers exemples, à ses yeux particulièrement significatifs. Au travers de ceux-ci, c’est également une nouvelle conception de la recherche et de son lien avec la formation qui se fait jour. Cette même recherche, du moins telle qu’elle se développe dans certains instituts de formation ayant fait le choix de se doter de laboratoires ou de « services recherche », est au cœur de l’article de Maëlle Moalic-Minnaert. Celle-ci met à profit son passage durant une année, à l’issue de son parcours doctoral, dans l’un de ces services, pour « documenter la dissonance entre le projet affiché » par celui-ci de devenir un « véritable » laboratoire de recherche et sa capacité à y parvenir, compte tenu notamment des contraintes institutionnelles et partenariales auxquelles il doit faire face. Dans les faits, les démarches évaluatives constituent une part importante de son activité, tout comme celles consistant à « accompagner les collectivités territoriales », les pratiques de collecte des données n’étant par ailleurs pas toujours conformes aux canons de l’exigence académique. D’où le constat de l’autrice selon lequel « en dépit de son aspiration à privilégier la recherche, le service reste “à mi-chemin entre une logique de savoirs et une logique d’actions” ». L’une des causes de cette situation étant, en plus des exigences de rentabilité et de productivité qui pèsent sur le service, à chercher également du côté des modes de socialisation des docteurs et des doctorants qui y travaillent et qui se sont pour partie réalisés à distance du monde académique. Leur expérience antérieure de travailleurs sociaux pouvant cependant constituer un atout lorsqu’il s’agit de conduire des recherches de type collaboratif." |
| En ligne : |
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2022-2.htm |
| Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37994 |
| ![Former à l’intervention sociale : Comment pensent (et font penser) les instituts de formation à l’intervention sociale et au travail social professionnels [Dossier] vignette](http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/images/vide.png) |


 Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheFormer à l’intervention sociale : Comment pensent (et font penser) les instituts de formation à l’intervention sociale et au travail social professionnels [Dossier] / Yves Lacascade in Pensée plurielle, 56 (2022)

Se défaire de l’usager en soi : Premières réflexions sur la formation des travailleurs sociaux, ses limites et ses dérives en tant qu’injonction au changement et imposition d’un travail sur soi / Yves Lacascade in Pensée plurielle, 56 (2022)


![Former à l’intervention sociale : Comment pensent (et font penser) les instituts de formation à l’intervention sociale et au travail social professionnels [Dossier] vignette](http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/images/vide.png)