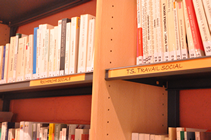Centre de documentation HELHa Cardijn Louvain-la-Neuve
Horaires d'ouverture (en période scolaire)
Lundi : 9h-12h30 / 13h15-17h
Mardi, Mercredi : 10h-14h
Jeudi : 13h-16h45
Vendredi : Fermé
Fermetures pendant les congés scolaires :
- du 29/04/2024 au 12/05/2024 inclus
- du 11/07/2024 au 15/08/2024 inclus
Bienvenue au Centre de documentation de la HELHa Cardijn Louvain-la-Neuve
Le centre de documentation de la HELHa Cardijn LLN met à disposition de ses lecteurs un fonds documentaire spécialisé dans les domaines pouvant intéresser – de près ou de loin - les (futur·e·s) travailleur·euse·s sociaux·ales : travail social, sociologie, psychologie, droit, santé, économie, pédagogie, immigration, vieillissement, famille, précarité, délinquance, emploi, communication, etc.
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur


 Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheComprendre le social dans la durée : les études longitudinales en sciences sociales / Joanie Cayouette-Remblière
Titre : Comprendre le social dans la durée : les études longitudinales en sciences sociales Type de document : texte imprimé Auteurs : Joanie Cayouette-Remblière, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Bertrand Geay, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Patrick Lehingue, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Pierre Antoine Chauvin ; Xavier Thierry ; Thomas Pilorin ; Jean-Louis Lanoë ; Fabien Truong ; Anne Muxel ; Pierre Mercklé ; Sylvie Octobre ; Pierre Doray ; Nicolas Bastien ; Benoït Laplante ; Marie-Paule Couto ; François Buton ; Claire Lemercier ; Nicolas Mariot ; Diane Delacourt ; Sophie Orange Editeur : Rennes Cedex [France] : Presses universitaires de Rennes (PUR) Année de publication : 2018 Collection : Res Publica Importance : 1 vol. (190 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7535-7470-0 Langues : Français (fre) Catégories : TS
Sciences sociales :Sciences sociales -- Méthodologie:Méthode longitudinale # Sciences sociales :Sciences sociales -- Recherche # Sociologie:Sociologie -- MéthodologieIndex. décimale : ME1 Recherche sociale / Statistiques - Généralités Résumé : "En 1966, H. Becker écrivait que - les sociologues aiment parler de fonctionnement. de processus, etc., mais que leurs méthodes les empêchent, en général, de saisir concrètement les processus dont ils parlent si abondamment. Près de cinquante ans plus tard, les techniques permettant de saisir les processus in itinere, que l'on a pris pour habitude de qualifier de longitudinales se sont développées.
Ce qui frappe aujourd'hui, c'est moins l'absence de méthodes ajustées à l'étude longitudinale des phénomènes que la diversité des techniques et la dispersion des lieux où elles sont débattues. Ces méthodes de recueil et d'analyse longitudinales sont rarement. discutées ensemble et sont au contraire souvent présentées comme constitutives de traditions de recherche opposées. C'est à ces différentes manières de faire usage des techniques longitudinales que cet ouvrage voudrait constituer une introduction.
En partant d'exemples précis d'études conduites dans des domaines aussi différents que la participation électorale, la socialisation enfantine ou l'intégration des populations migrantes, on souhaite d'abord restituer les enjeux pratiques, théoriques et épistémologiques des différentes techniques de type longitudinal, qu'elles relèvent de l'ethnographie, de la statistique sur grands échantillons de population, du traitement de corpus de documents ou d'archives et de tous les cas intermédiaires de production et d'analyse des données.
Résolument pratique, l'approche proposée pourra suggérer la part d'illusion qu'enferme la démarche longitudinale elle-même, comme ambition de rendre exhaustivement compte du social en train de se faire."Note de contenu : Sommaire
Partie 1. Comment faire des enquêtes longitudinales ? - 1. Construire sa base de données (P. A. Chauvin) / 2. La cohorte Elfe : de quels enfants est-elle et sera-t-elle représentative ? (X. Thierry, Th. Pilorin, J.-L. Lanoë) / 3. Produire et conserver le lien avec les enquêtés (B. Geay) / 4. La relation aux enquêtés et l'accumulation des données au fil du temps (F. Truong) / 5. Comprendre le rôle de l'âge (A. Muxel) / 6. Quand le longitudinal révèle des incohérences (P. Mercklé, S. Octobre)
Partie 2. Les apports historiques des études longitudinales - 7. Analyse longitudinale et précautions méthodologiques : autour la hausse des droits de scolarité sur l'accès aux études universitaires (P. Doray, N. Bastien, B. Laplante) / 8. Repenser l'intégration socioéconomique des pieds-noirs en France métropolitaine à l'aide des études longitudinales (M.-P. Couto) / 9. La maisonnée fait la participation : une analyse des itinéraires de participation électorale dans un bureau de vote francilien (1982-2008) (Fr. Buton, Cl. Lemercier, N. Mariot) / 10. Le vote intermittent comme norme électorale : suivi longitudinal d'un bureau de vote et enseignements (D. Delacourt, P. Lehingue) / 11. Le risque de la réduction linéaire des parcours dans les études longitudinales (S. Orange) / 12. Sociologiser les mobilisations et les découragements scolaires grâce à l'étude localisée de trajectoires scolaires (J. Cayouette-Remblière)Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26555 Comprendre le social dans la durée : les études longitudinales en sciences sociales [texte imprimé] / Joanie Cayouette-Remblière, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Bertrand Geay, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Patrick Lehingue, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Pierre Antoine Chauvin ; Xavier Thierry ; Thomas Pilorin ; Jean-Louis Lanoë ; Fabien Truong ; Anne Muxel ; Pierre Mercklé ; Sylvie Octobre ; Pierre Doray ; Nicolas Bastien ; Benoït Laplante ; Marie-Paule Couto ; François Buton ; Claire Lemercier ; Nicolas Mariot ; Diane Delacourt ; Sophie Orange . - Rennes Cedex (Campus de la Harpe, rue du doyen Denis-Leroy, 2, 35044, France) : Presses universitaires de Rennes (PUR), 2018 . - 1 vol. (190 p.) ; 24 cm. - (Res Publica) .
ISBN : 978-2-7535-7470-0
Langues : Français (fre)
Catégories : TS
Sciences sociales :Sciences sociales -- Méthodologie:Méthode longitudinale # Sciences sociales :Sciences sociales -- Recherche # Sociologie:Sociologie -- MéthodologieIndex. décimale : ME1 Recherche sociale / Statistiques - Généralités Résumé : "En 1966, H. Becker écrivait que - les sociologues aiment parler de fonctionnement. de processus, etc., mais que leurs méthodes les empêchent, en général, de saisir concrètement les processus dont ils parlent si abondamment. Près de cinquante ans plus tard, les techniques permettant de saisir les processus in itinere, que l'on a pris pour habitude de qualifier de longitudinales se sont développées.
Ce qui frappe aujourd'hui, c'est moins l'absence de méthodes ajustées à l'étude longitudinale des phénomènes que la diversité des techniques et la dispersion des lieux où elles sont débattues. Ces méthodes de recueil et d'analyse longitudinales sont rarement. discutées ensemble et sont au contraire souvent présentées comme constitutives de traditions de recherche opposées. C'est à ces différentes manières de faire usage des techniques longitudinales que cet ouvrage voudrait constituer une introduction.
En partant d'exemples précis d'études conduites dans des domaines aussi différents que la participation électorale, la socialisation enfantine ou l'intégration des populations migrantes, on souhaite d'abord restituer les enjeux pratiques, théoriques et épistémologiques des différentes techniques de type longitudinal, qu'elles relèvent de l'ethnographie, de la statistique sur grands échantillons de population, du traitement de corpus de documents ou d'archives et de tous les cas intermédiaires de production et d'analyse des données.
Résolument pratique, l'approche proposée pourra suggérer la part d'illusion qu'enferme la démarche longitudinale elle-même, comme ambition de rendre exhaustivement compte du social en train de se faire."Note de contenu : Sommaire
Partie 1. Comment faire des enquêtes longitudinales ? - 1. Construire sa base de données (P. A. Chauvin) / 2. La cohorte Elfe : de quels enfants est-elle et sera-t-elle représentative ? (X. Thierry, Th. Pilorin, J.-L. Lanoë) / 3. Produire et conserver le lien avec les enquêtés (B. Geay) / 4. La relation aux enquêtés et l'accumulation des données au fil du temps (F. Truong) / 5. Comprendre le rôle de l'âge (A. Muxel) / 6. Quand le longitudinal révèle des incohérences (P. Mercklé, S. Octobre)
Partie 2. Les apports historiques des études longitudinales - 7. Analyse longitudinale et précautions méthodologiques : autour la hausse des droits de scolarité sur l'accès aux études universitaires (P. Doray, N. Bastien, B. Laplante) / 8. Repenser l'intégration socioéconomique des pieds-noirs en France métropolitaine à l'aide des études longitudinales (M.-P. Couto) / 9. La maisonnée fait la participation : une analyse des itinéraires de participation électorale dans un bureau de vote francilien (1982-2008) (Fr. Buton, Cl. Lemercier, N. Mariot) / 10. Le vote intermittent comme norme électorale : suivi longitudinal d'un bureau de vote et enseignements (D. Delacourt, P. Lehingue) / 11. Le risque de la réduction linéaire des parcours dans les études longitudinales (S. Orange) / 12. Sociologiser les mobilisations et les découragements scolaires grâce à l'étude localisée de trajectoires scolaires (J. Cayouette-Remblière)Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26555 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité ME1 CAY CO Livre Centre de documentation HELHa Cardijn LLN Salle de lecture (Rayons thématiques) Disponible
Titre : Ecrire les sciences sociales, écrire en sciences sociales Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Le Bart, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Florian Mazel, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Fanny Rinck ; Jean-Yves Trépos ; Marion Lemoine-Schonne ; Laurent Rousvoal ; Matthieu Leprince, Personne interviewée ; Fabien Moizeau, Personne interviewée ; Grégor Marchand ; Hélène Bailleul, Personne interviewée ; Benoît Feildel, Personne interviewée ; Adeline Latimier ; Jean-Manuel Warnet ; Nathalie Heinich ; Annick Madec ; Caroline Guittet ; Sylvain Venayre ; Philippe Artières ; Christophe Gimbert ; Pierre-Henry Frangne ; Caroline Muller, Personne interviewée ; Erik Neveu ; Jean Boutier ; Léa Sénégas ; Séverine Nikel, Personne interviewée ; Philippe Carrard Editeur : Rennes [France] : Maison des sciences de l'Homme en Bretagne Année de publication : 2021 Autre Editeur : Rennes Cedex [France] : Presses universitaires de Rennes (PUR) Collection : Métier de chercheur·e num. 2 Importance : 1 vol. (321 p.) Présentation : ill. en noir et blanc Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7535-8327-6 Langues : Français (fre) Catégories : TS
Rédaction scientifique et technique # Sciences sociales :Sciences sociales -- RechercheIndex. décimale : ME1 Recherche sociale / Statistiques - Généralités Résumé : "Thèses, articles, livres… tous les chercheurs en sciences humaines et sociales consacrent une partie de leur temps à écrire. Ce dénominateur commun masque à l’évidence une grande diversité quant aux pratiques d’écriture : écrire un manuel juridique n’est pas écrire un article dans une revue d’économie ; rédiger un rapport de recherche pour un organisme public n’est pas rédiger un essai pour un éditeur soucieux de toucher un lectorat aussi large que possible…
Malgré cette diversité, l’acte d’écriture demeure une pratique partagée. L’objectif de ce livre, qui entend croiser témoignages et analyses, est certes de donner à voir la diversité des pratiques d’écriture mais aussi et surtout de faire dialoguer les chercheurs autour des manières de mettre leur idéal scientifique à l’épreuve de l’écriture. Car écrire en sciences humaines et sociales, ce n’est jamais simplement rédiger, ce n’est jamais simplement consigner un résultat de recherche. L’écriture n’est ni simple, ni transparente, ni innocente. En invitant les chercheurs à dire leur rapport à l’écriture, et même à raconter leurs expériences (heureuses ou douloureuses), ce second volet de la collection « Métier de chercheur·e » entend interroger frontalement une pratique trop peu souvent mise en discussion dans l’espace académique."Note de contenu : Sommaire
Écrire les sciences sociales, écrire en sciences sociales. Introduction générale (Ch. Le Bart, Fl. Mazel)
Partie 1. L'écriture scientifique comme objet : la science de la science - Regard de la linguistique sur l’écriture d’articles en sciences humaines et sociales (F. Rinck) / Manières de faire ou système de normes ? Politique et pragmatique de l’écriture en sociologie (J.-Y. Trépos)
Partie 2. Disciplines d'écritures et écritures disciplinaires - Écrire en droit (M. Lemoine-Schonne, L. Rousvoal) / Écrire en économie. La loi des grandes revues (Entr. avec M. Leprince et F. Moizeau) / Écrire en archéologue (Gr. Marchand) / Écrire et publier en urbanisme, l’épreuve de l’interdisciplinarité (Entr. avec H. Bailleul et B. Feildel)
Partie 3. La tentation littéraire - Écrire sur l’écriture. L’exercice paradoxal de la thèse de lettres (A. Latimier) / Comment taire le commentaire ? Réflexions sur l’écriture de la recherche en littérature (J.-M. Warnet) / Retour sur Une histoire de France. Entre sciences sociales et littérature (N. Heinich) / La sociologie narrative. Une sociologie publique (A. Madec) / Quand l’écriture académique ne suffit plus. La littérature au secours de la géographie (C. Guittet)
Partie 4. Innovations, expérimentations et hérésies - Faire de l’histoire en bande dessinée (S. Venayre) / Comment tenter d’écrire l’histoire en mode mineur. Propositions (Ph. Artières) / Écriture sociologique et écriture journalistique. S’entendre pour « écrire vrai » ? (Ch. Gimbert) / Essayer d’écrire une philosophie de l’alpinisme (P.-H. Frangne) / « J’aime écrire ». L’expérience du carnet de recherche (Entr. avec C. Muller)
Partie 5. Pages blanches et apprentissages - Pour une écriture réflexive et désinhibée des sciences sociales (E. Neveu) / Sur une expérience de l’enseignement de l’écriture en sciences humaines et sociales (J. Boutier) / L’écriture en doctorat. Un processus initiatique (L. Sénégas) / Accompagner l’écriture en sciences sociales. Un point
de vue de journaliste et d’éditrice (Entr. avec S. Nikel)
Conclusion. Écrire en sciences humaines et sociales : une perspective formaliste (Ph. Carrard)Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33773 Ecrire les sciences sociales, écrire en sciences sociales [texte imprimé] / Christian Le Bart, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Florian Mazel, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Fanny Rinck ; Jean-Yves Trépos ; Marion Lemoine-Schonne ; Laurent Rousvoal ; Matthieu Leprince, Personne interviewée ; Fabien Moizeau, Personne interviewée ; Grégor Marchand ; Hélène Bailleul, Personne interviewée ; Benoît Feildel, Personne interviewée ; Adeline Latimier ; Jean-Manuel Warnet ; Nathalie Heinich ; Annick Madec ; Caroline Guittet ; Sylvain Venayre ; Philippe Artières ; Christophe Gimbert ; Pierre-Henry Frangne ; Caroline Muller, Personne interviewée ; Erik Neveu ; Jean Boutier ; Léa Sénégas ; Séverine Nikel, Personne interviewée ; Philippe Carrard . - Rennes (France) : Maison des sciences de l'Homme en Bretagne : Rennes Cedex (Campus de la Harpe, rue du doyen Denis-Leroy, 2, 35044, France) : Presses universitaires de Rennes (PUR), 2021 . - 1 vol. (321 p.) : ill. en noir et blanc ; 21 cm. - (Métier de chercheur·e; 2) .
ISBN : 978-2-7535-8327-6
Langues : Français (fre)
Catégories : TS
Rédaction scientifique et technique # Sciences sociales :Sciences sociales -- RechercheIndex. décimale : ME1 Recherche sociale / Statistiques - Généralités Résumé : "Thèses, articles, livres… tous les chercheurs en sciences humaines et sociales consacrent une partie de leur temps à écrire. Ce dénominateur commun masque à l’évidence une grande diversité quant aux pratiques d’écriture : écrire un manuel juridique n’est pas écrire un article dans une revue d’économie ; rédiger un rapport de recherche pour un organisme public n’est pas rédiger un essai pour un éditeur soucieux de toucher un lectorat aussi large que possible…
Malgré cette diversité, l’acte d’écriture demeure une pratique partagée. L’objectif de ce livre, qui entend croiser témoignages et analyses, est certes de donner à voir la diversité des pratiques d’écriture mais aussi et surtout de faire dialoguer les chercheurs autour des manières de mettre leur idéal scientifique à l’épreuve de l’écriture. Car écrire en sciences humaines et sociales, ce n’est jamais simplement rédiger, ce n’est jamais simplement consigner un résultat de recherche. L’écriture n’est ni simple, ni transparente, ni innocente. En invitant les chercheurs à dire leur rapport à l’écriture, et même à raconter leurs expériences (heureuses ou douloureuses), ce second volet de la collection « Métier de chercheur·e » entend interroger frontalement une pratique trop peu souvent mise en discussion dans l’espace académique."Note de contenu : Sommaire
Écrire les sciences sociales, écrire en sciences sociales. Introduction générale (Ch. Le Bart, Fl. Mazel)
Partie 1. L'écriture scientifique comme objet : la science de la science - Regard de la linguistique sur l’écriture d’articles en sciences humaines et sociales (F. Rinck) / Manières de faire ou système de normes ? Politique et pragmatique de l’écriture en sociologie (J.-Y. Trépos)
Partie 2. Disciplines d'écritures et écritures disciplinaires - Écrire en droit (M. Lemoine-Schonne, L. Rousvoal) / Écrire en économie. La loi des grandes revues (Entr. avec M. Leprince et F. Moizeau) / Écrire en archéologue (Gr. Marchand) / Écrire et publier en urbanisme, l’épreuve de l’interdisciplinarité (Entr. avec H. Bailleul et B. Feildel)
Partie 3. La tentation littéraire - Écrire sur l’écriture. L’exercice paradoxal de la thèse de lettres (A. Latimier) / Comment taire le commentaire ? Réflexions sur l’écriture de la recherche en littérature (J.-M. Warnet) / Retour sur Une histoire de France. Entre sciences sociales et littérature (N. Heinich) / La sociologie narrative. Une sociologie publique (A. Madec) / Quand l’écriture académique ne suffit plus. La littérature au secours de la géographie (C. Guittet)
Partie 4. Innovations, expérimentations et hérésies - Faire de l’histoire en bande dessinée (S. Venayre) / Comment tenter d’écrire l’histoire en mode mineur. Propositions (Ph. Artières) / Écriture sociologique et écriture journalistique. S’entendre pour « écrire vrai » ? (Ch. Gimbert) / Essayer d’écrire une philosophie de l’alpinisme (P.-H. Frangne) / « J’aime écrire ». L’expérience du carnet de recherche (Entr. avec C. Muller)
Partie 5. Pages blanches et apprentissages - Pour une écriture réflexive et désinhibée des sciences sociales (E. Neveu) / Sur une expérience de l’enseignement de l’écriture en sciences humaines et sociales (J. Boutier) / L’écriture en doctorat. Un processus initiatique (L. Sénégas) / Accompagner l’écriture en sciences sociales. Un point
de vue de journaliste et d’éditrice (Entr. avec S. Nikel)
Conclusion. Écrire en sciences humaines et sociales : une perspective formaliste (Ph. Carrard)Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33773 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité ME1 LEB EC Livre Centre de documentation HELHa Cardijn LLN Salle de lecture (Rayons thématiques) Disponible
Titre : Ecritures créatives : Représentations et enjeux professionnels Type de document : texte imprimé Auteurs : Dominique Ulma, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Anne Pauzet, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Anne Prouteau, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Rennes Cedex [France] : Presses universitaires de Rennes (PUR) Année de publication : 2022 Collection : Interférences Importance : 1 vol. (352 p.) Format : 21cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7535-8614-7 Langues : Français (fre) Catégories : TS
Art -- Aspect social # Art-thérapie # Ateliers d'écriture # Bibliothérapie # Créativité # Écriture -- Aspect cognitif # Intégration sociale # Lecture:Lecture -- Étude et enseignement # Littérature # Réalisation de soiRésumé : "Ce livre étudie les processus d’écriture créative à l’œuvre dans les domaines professionnels (insertion sociale, développement personnel, entreprise, domaine thérapeutique), personnels, mais aussi éducatifs (universitaires, scolaires, périscolaires). Il analyse les enjeux contemporains de ces pratiques nouvelles en termes d’évolution des représentations, de transfert de compétences, de processus de création, d’autodidaxie. Il approfondit les perspectives épistémologiques des ateliers d’écriture contemporains en montrant en quoi ces pratiques amènent à penser un changement de paradigme dans les domaines de la formation et dans le monde professionnel. Il revient sur la question, déjà largement étudiée mais ici revisitée, de l’apprentissage de l’écriture. Si écrire s’apprend, quels sont les dispositifs de son apprentissage et quels sont les présupposés théoriques et les résultats de ces dispositifs ? Inscrit dans son temps, cet ouvrage pose la question de la transmission et du transfert de compétences. Mais surtout : au sein de contextes encore peu étudiés, il veut relever le défi d’un « tous capables créateurs »." Note de contenu : Sommaire
Introduction / Première partie : Perspectives épistémologiques : vers un changement de paradigme / Deuxième partie : Développement personnel par l'art / Troisième partie : Ecrire, ça s'apprend ? ou "En lisant, en écrivant" / Quatrième partie : Transmission et transfert de compétences vers le monde professionnelPermalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35454 Ecritures créatives : Représentations et enjeux professionnels [texte imprimé] / Dominique Ulma, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Anne Pauzet, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Anne Prouteau, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Rennes Cedex (Campus de la Harpe, rue du doyen Denis-Leroy, 2, 35044, France) : Presses universitaires de Rennes (PUR), 2022 . - 1 vol. (352 p.) ; 21cm. - (Interférences) .
ISBN : 978-2-7535-8614-7
Langues : Français (fre)
Catégories : TS
Art -- Aspect social # Art-thérapie # Ateliers d'écriture # Bibliothérapie # Créativité # Écriture -- Aspect cognitif # Intégration sociale # Lecture:Lecture -- Étude et enseignement # Littérature # Réalisation de soiRésumé : "Ce livre étudie les processus d’écriture créative à l’œuvre dans les domaines professionnels (insertion sociale, développement personnel, entreprise, domaine thérapeutique), personnels, mais aussi éducatifs (universitaires, scolaires, périscolaires). Il analyse les enjeux contemporains de ces pratiques nouvelles en termes d’évolution des représentations, de transfert de compétences, de processus de création, d’autodidaxie. Il approfondit les perspectives épistémologiques des ateliers d’écriture contemporains en montrant en quoi ces pratiques amènent à penser un changement de paradigme dans les domaines de la formation et dans le monde professionnel. Il revient sur la question, déjà largement étudiée mais ici revisitée, de l’apprentissage de l’écriture. Si écrire s’apprend, quels sont les dispositifs de son apprentissage et quels sont les présupposés théoriques et les résultats de ces dispositifs ? Inscrit dans son temps, cet ouvrage pose la question de la transmission et du transfert de compétences. Mais surtout : au sein de contextes encore peu étudiés, il veut relever le défi d’un « tous capables créateurs »." Note de contenu : Sommaire
Introduction / Première partie : Perspectives épistémologiques : vers un changement de paradigme / Deuxième partie : Développement personnel par l'art / Troisième partie : Ecrire, ça s'apprend ? ou "En lisant, en écrivant" / Quatrième partie : Transmission et transfert de compétences vers le monde professionnelPermalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35454 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité CU1 ULM EC Livre Centre de documentation HELHa Cardijn LLN Salle de lecture (Rayons thématiques) Sorti jusqu'au 01/03/2023 Faire et défaire les liens familiaux : usages et pratiques du droit en contexte migratoire / Aurélie Fillod-Chabaud
Titre : Faire et défaire les liens familiaux : usages et pratiques du droit en contexte migratoire Type de document : texte imprimé Auteurs : Aurélie Fillod-Chabaud, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Laura Odasso, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Delphine Perrin ; Sylvie Sarolea ; Laura Merla ; Dani Kranz ; Olivier Struelens ; Barbara Truffin ; Ferdinand Mben Lissouck ; Gaëlle Meslay ; Agnès Martial ; Marine Pouliquen ; Melissa Blanchard ; Katherine E. Hoffman ; Serge Slama, Postfacier, auteur du colophon, etc. Editeur : Rennes Cedex [France] : Presses universitaires de Rennes (PUR) Année de publication : 2020 Collection : Le Sens social Importance : 1 vol. (212 p.) Présentation : tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7535-7936-1 Note générale : Communications présentées au colloque Migrations familiales et usages du droit. Acteurs, normes et régulations de la circulation internationale des familles qui s'est tenu à Marseille, les 22 et 23 février 2018. Langues : Français (fre) Catégories : TS
Famille -- Migration # Famille:Famille -- Droit # Regroupement familialIndex. décimale : IM0 Immigration / Interculturalité - Généralités Résumé : "Ces dernières décennies, les migrations internationales ont considérablement transformé les manières de "faire famille". Des individus migrent pour rejoindre leur conjoint ; d'autres donnent naissance à un enfant dans un pays où ils n'ont pas le droit de séjourner ; des mineurs sont conçus à l'étranger par GPA ou PMA; des parents en couple mixte n'arrivent pas à transmettre la nationalité à leur enfant pourtant né sur le territoire. Soumises à des normes nationales et internationales, ces migrations ont un impact sur la formation et la dissolution de la conjugalité, sur la filiation et la parenté, sur la reproduction et la procréation. Ces moments constitutifs de la vie familiale sont régulés par un pluralisme juridique. Objet fluide, le droit est travaillé par le législateur et les juridictions, il est incorporé par les individus ordinaires et mobilisé dans des contextes sociaux où des acteurs ayant une position sociale et des ressources différentes interagissent.
À l’aide d’un « passage par le droit », cet ouvrage interroge l’imbrication entre État(s), nation, liens familiaux et migrations. Il analyse, d’une part, comment le droit redessine le contour des liens familiaux et, d’autre part, comment les individus se saisissent du droit pour « faire famille » dans des contextes géographiques et juridiques variés. Grâce à des contributions qui dépassent les frontières disciplinaires et mobilisent des matériaux d’enquête variés, il montre que la transversalité des analyses en droit et sciences sociales est possible et riche."Note de contenu : Table des matières
Introduction générale (A. Fillod-Chaubaud, L. Odasso)
Partie 1. Frottement des échelles juridiques : protection, limites et injonctions normatives - Introduction à la première partie (D. Perrin) / Migrantes ou sédentaires : des familles ontologiquement différentes ? (S. Sarolea, L. Merla) / Saisir le droit pour ceux qu'on aime. "Judéité", démocratie et "israélisme" (D. Kranz) / Le droit face à l'enlèvement parental international. La poursuite de l'intérêt de l'enfant au prisme du pluralisme juridique (O. Struelens)
Partie 2. Consciences du droit et trajectoires familiales en contexte migratoire - Introduction à la deuxième partie (B. Truffin) / De l'exil des familles aux frontières des possibles. Politiques hostiles, entraves administratives et "art de faire" (X. Briké) / Les apprentissages féminins de la conjugalité et de la sexualité dans un camp de réfugiés au Cameroun. Injonctions normatives et usages du droit (F. Mben Lissouck) / Usages du droit et poids des contraintes. Une tension dans l'accès aux migrations procréatives et la parentalité pour les couples de même sexe (G. Meslay)
Partie 3. Se jouer des frontières : migrations procréatives, accès à la nation et filiation - Introduction à la troisième partie (A. Martial) / Les migrations procréatives des familles infertiles. Une réflexion sur le contexte juridique franco-européen (M. Pouliquen) / Usages du droit au retour dans l'Italie du Nord-Est. Entre nouvelles migrations et transmission familiale (M. Blanchard) / Famille, filiation et foi. Le traitement judiciaire de la tutelle islamique (kafala) en France et aux Etats-Unis (K. E. Hoffman)
Conclusion générale. Pour une sociologie juridique des migrations et des circulations familiales (A. Fillod-Chabaud, L. Odasso)
Postface (S. Slama)Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31260 Faire et défaire les liens familiaux : usages et pratiques du droit en contexte migratoire [texte imprimé] / Aurélie Fillod-Chabaud, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Laura Odasso, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Delphine Perrin ; Sylvie Sarolea ; Laura Merla ; Dani Kranz ; Olivier Struelens ; Barbara Truffin ; Ferdinand Mben Lissouck ; Gaëlle Meslay ; Agnès Martial ; Marine Pouliquen ; Melissa Blanchard ; Katherine E. Hoffman ; Serge Slama, Postfacier, auteur du colophon, etc. . - Rennes Cedex (Campus de la Harpe, rue du doyen Denis-Leroy, 2, 35044, France) : Presses universitaires de Rennes (PUR), 2020 . - 1 vol. (212 p.) : tabl. ; 24 cm. - (Le Sens social) .
ISBN : 978-2-7535-7936-1
Communications présentées au colloque Migrations familiales et usages du droit. Acteurs, normes et régulations de la circulation internationale des familles qui s'est tenu à Marseille, les 22 et 23 février 2018.
Langues : Français (fre)
Catégories : TS
Famille -- Migration # Famille:Famille -- Droit # Regroupement familialIndex. décimale : IM0 Immigration / Interculturalité - Généralités Résumé : "Ces dernières décennies, les migrations internationales ont considérablement transformé les manières de "faire famille". Des individus migrent pour rejoindre leur conjoint ; d'autres donnent naissance à un enfant dans un pays où ils n'ont pas le droit de séjourner ; des mineurs sont conçus à l'étranger par GPA ou PMA; des parents en couple mixte n'arrivent pas à transmettre la nationalité à leur enfant pourtant né sur le territoire. Soumises à des normes nationales et internationales, ces migrations ont un impact sur la formation et la dissolution de la conjugalité, sur la filiation et la parenté, sur la reproduction et la procréation. Ces moments constitutifs de la vie familiale sont régulés par un pluralisme juridique. Objet fluide, le droit est travaillé par le législateur et les juridictions, il est incorporé par les individus ordinaires et mobilisé dans des contextes sociaux où des acteurs ayant une position sociale et des ressources différentes interagissent.
À l’aide d’un « passage par le droit », cet ouvrage interroge l’imbrication entre État(s), nation, liens familiaux et migrations. Il analyse, d’une part, comment le droit redessine le contour des liens familiaux et, d’autre part, comment les individus se saisissent du droit pour « faire famille » dans des contextes géographiques et juridiques variés. Grâce à des contributions qui dépassent les frontières disciplinaires et mobilisent des matériaux d’enquête variés, il montre que la transversalité des analyses en droit et sciences sociales est possible et riche."Note de contenu : Table des matières
Introduction générale (A. Fillod-Chaubaud, L. Odasso)
Partie 1. Frottement des échelles juridiques : protection, limites et injonctions normatives - Introduction à la première partie (D. Perrin) / Migrantes ou sédentaires : des familles ontologiquement différentes ? (S. Sarolea, L. Merla) / Saisir le droit pour ceux qu'on aime. "Judéité", démocratie et "israélisme" (D. Kranz) / Le droit face à l'enlèvement parental international. La poursuite de l'intérêt de l'enfant au prisme du pluralisme juridique (O. Struelens)
Partie 2. Consciences du droit et trajectoires familiales en contexte migratoire - Introduction à la deuxième partie (B. Truffin) / De l'exil des familles aux frontières des possibles. Politiques hostiles, entraves administratives et "art de faire" (X. Briké) / Les apprentissages féminins de la conjugalité et de la sexualité dans un camp de réfugiés au Cameroun. Injonctions normatives et usages du droit (F. Mben Lissouck) / Usages du droit et poids des contraintes. Une tension dans l'accès aux migrations procréatives et la parentalité pour les couples de même sexe (G. Meslay)
Partie 3. Se jouer des frontières : migrations procréatives, accès à la nation et filiation - Introduction à la troisième partie (A. Martial) / Les migrations procréatives des familles infertiles. Une réflexion sur le contexte juridique franco-européen (M. Pouliquen) / Usages du droit au retour dans l'Italie du Nord-Est. Entre nouvelles migrations et transmission familiale (M. Blanchard) / Famille, filiation et foi. Le traitement judiciaire de la tutelle islamique (kafala) en France et aux Etats-Unis (K. E. Hoffman)
Conclusion générale. Pour une sociologie juridique des migrations et des circulations familiales (A. Fillod-Chabaud, L. Odasso)
Postface (S. Slama)Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31260 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité IM0 FIL FA Livre Centre de documentation HELHa Cardijn LLN Salle de lecture (Rayons thématiques) Disponible L'inversion du genre : quand les métiers masculins se conjuguent au féminin... et réciproquement / Yvonne Guichard-Claudic
Titre : L'inversion du genre : quand les métiers masculins se conjuguent au féminin... et réciproquement Type de document : texte imprimé Auteurs : Yvonne Guichard-Claudic, Directeur de la recherche ; Danièle Kergoat, Directeur de la recherche ; Alain Vilbrod, Directeur de la recherche Editeur : Rennes Cedex [France] : Presses universitaires de Rennes (PUR) Année de publication : 2008 Collection : Des sociétés Importance : 401 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7535-0589-6 Langues : Français (fre) Catégories : Cardijn
Femme- Homme # Genre # Monde du travailIndex. décimale : MT3 Discrimination au travail Résumé : "Femmes pompiers ou médecins, cadres d'entreprise, magistrates, conductrices de bus ou de camions, peintres en bâtiment ou carreleuses... mais aussi hommes sages-femmes ou caissiers de supermarché, infirmiers, assistants sociaux ou instituteurs en école maternelle: autant d'exemples de l'avancée en mixité dans des bastions longtemps monosexués. La mixité n'est donc pas seulement une question de co-présence de femmes et d'hommes dans différents espaces sociaux. Elle se traduit aussi par la fin de l'exclusivisme de genre attaché à certains métiers. Il est certes important d'en prendre la mesure précise, statistiques à l'appui, mais une évaluation chiffrée ne saurait suffire pour comprendre ce qui se joue dans ces situations atypiques. Le même métier est rarement exercé dans les mêmes conditions, de travail, de rémunération, de promotion selon qu'il l'est par un homme ou par une femme. Des travaux qualitatifs fins et diversifiés, tels ceux qui sont présentés dans cet ouvrage, permettent d'observer par le menu ce qui se transforme, ce qui résiste, ce qui se recompose, dans le but de saisir le sens des logiques sociales complexes qui sont à l'œuvre. Parler d'inversion du genre à propos de ces situations et positions non traditionnelles, c'est donc moins décrire une situation que poser la question de savoir dans quelle mesure l'inversion des positions sexuées est de nature à remettre en cause les processus de catégorisation et de hiérarchisation que désigne le concept de genre." Note de contenu : Table des matières
1. Des trajectoires sexuées dans l'accès et le maintien en position atypique / 2. Quand l'avancée en mixité est le fait des femmes / 3. Quand l'avancée en mixité est le fait des hommes / 4. Les définitions du genre et leurs enjeux en situation d'inversionPermalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14547 L'inversion du genre : quand les métiers masculins se conjuguent au féminin... et réciproquement [texte imprimé] / Yvonne Guichard-Claudic, Directeur de la recherche ; Danièle Kergoat, Directeur de la recherche ; Alain Vilbrod, Directeur de la recherche . - Rennes Cedex (Campus de la Harpe, rue du doyen Denis-Leroy, 2, 35044, France) : Presses universitaires de Rennes (PUR), 2008 . - 401 p. ; 24 cm. - (Des sociétés) .
ISBN : 978-2-7535-0589-6
Langues : Français (fre)
Catégories : Cardijn
Femme- Homme # Genre # Monde du travailIndex. décimale : MT3 Discrimination au travail Résumé : "Femmes pompiers ou médecins, cadres d'entreprise, magistrates, conductrices de bus ou de camions, peintres en bâtiment ou carreleuses... mais aussi hommes sages-femmes ou caissiers de supermarché, infirmiers, assistants sociaux ou instituteurs en école maternelle: autant d'exemples de l'avancée en mixité dans des bastions longtemps monosexués. La mixité n'est donc pas seulement une question de co-présence de femmes et d'hommes dans différents espaces sociaux. Elle se traduit aussi par la fin de l'exclusivisme de genre attaché à certains métiers. Il est certes important d'en prendre la mesure précise, statistiques à l'appui, mais une évaluation chiffrée ne saurait suffire pour comprendre ce qui se joue dans ces situations atypiques. Le même métier est rarement exercé dans les mêmes conditions, de travail, de rémunération, de promotion selon qu'il l'est par un homme ou par une femme. Des travaux qualitatifs fins et diversifiés, tels ceux qui sont présentés dans cet ouvrage, permettent d'observer par le menu ce qui se transforme, ce qui résiste, ce qui se recompose, dans le but de saisir le sens des logiques sociales complexes qui sont à l'œuvre. Parler d'inversion du genre à propos de ces situations et positions non traditionnelles, c'est donc moins décrire une situation que poser la question de savoir dans quelle mesure l'inversion des positions sexuées est de nature à remettre en cause les processus de catégorisation et de hiérarchisation que désigne le concept de genre." Note de contenu : Table des matières
1. Des trajectoires sexuées dans l'accès et le maintien en position atypique / 2. Quand l'avancée en mixité est le fait des femmes / 3. Quand l'avancée en mixité est le fait des hommes / 4. Les définitions du genre et leurs enjeux en situation d'inversionPermalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=14547 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité MT3 GUI IN Livre Centre de documentation HELHa Cardijn LLN Salle de lecture (Rayons thématiques) Disponible Lutter contre les violences conjugales : féminisme, travail social, politique publique / Elisa Herman
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink