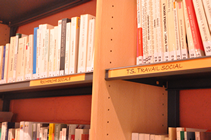Centre de documentation HELHa Cardijn Louvain-la-Neuve
Horaires d'ouverture (en période scolaire)
Lundi, Mardi, Mercredi :
8h30 - 12h30 / 13h15 - 17h
jeudi : matin sur RDV / 13h15 - 17h
vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h15 - 15h00
Fermé le lundi 27/01/2025
Bienvenue au Centre de documentation de la HELHa Cardijn Louvain-la-Neuve
Le centre de documentation de la HELHa Cardijn LLN met à disposition de ses lecteurs un fonds documentaire spécialisé dans les domaines pouvant intéresser – de près ou de loin - les (futur·e·s) travailleur·euse·s sociaux·ales : travail social, sociologie, psychologie, droit, santé, économie, pédagogie, immigration, vieillissement, famille, précarité, délinquance, emploi, communication, etc.
Bulletin 9 |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER SSO 9 (2024) | Périodique | Centre de documentation HELHa Cardijn LLN | Salle de lecture (Périodiques) | Disponible |
Dépouillements

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panier
Titre : Profil de santé de nos aîné·es Type de document : texte imprimé Auteurs : Katte Ackaert ; Hervé Avalosse ; Rebekka Verniest Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 4-43 Langues : Français (fre) Catégories : TS
Personnes âgées:Personnes âgées -- Santé et hygiène # Personnes âgées:Personnes âgées -- Soins # Recherche quantitative # Vieillissement # Vieillissement :Vieillissement de la populationRésumé : "Telle une antienne, nous entendons continuellement : « la Belgique vieillit ». Mais que devons-nous comprendre par là ? Le fait que le nombre et la proportion de personnes âgées au sein
de la population sont en croissance. Ainsi, les projections démographiques indiquent que le nombre de personnes de 80 ans et plus va doubler d’ici 2050. Pour tout un chacun, vieillir n’est pas forcément une mauvaise nouvelle : avoir la perspective d’une vie longue et épanouissante est plutôt positif. Toutefois, nous n’aurons pas tous et toutes l’opportunité de vieillir en bonne santé : beaucoup de personnes âgées feront face à des problèmes de santé (aigus et/ou chroniques) et de perte d’autonomie. Et comme le nombre de personnes âgées va s’accroître, le recours aux services de santé et d’aide va également s’intensifier. C’est donc à un défi sociétal considérable auquel nous devons faire face. Comment s’y préparer ? D’abord en dressant le profil de santé de nos aîné∙es. Dans quel état de santé sont-ils∙elles ? Dans quelle situation sociale sont-ils∙elles ? À quels soins font-ils∙elles appel ? La MC a déjà publié bien des études sur les soins aux aîné∙es. Mais elles étaient souvent partielles. Avec la présente étude, notre ambition est d’être systématique. Pour la première fois, nous analysons de façon globale le profil des aîné∙es de la MC, soit la population de nos membres ayant 65 ans et plus, au cours de la période 2016 à 2022. Quelques résultats
généraux ci-après.
Indicateurs d’état de santé :
• Les affections cardiovasculaires sont le problème de santé le plus fréquent (62% des 65 ans et plus). Viennent ensuite les problèmes de thrombose (41%), le diabète (18%), des pathologies mentales (13%). Environ un cinquième de nos aîné∙es ne présentent aucune des pathologies examinées dans cette étude.
• La proportion de personnes en soins palliatifs est assez faible : 1,5% pour les 65 ans et plus, 4% pour les 80 ans et plus.
• De l’ordre de 4% des 65 ans et plus (12% pour les 85 ans et plus) décèdent chaque année
Indicateurs de vulnérabilité sociale :
• La proportion de bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) est en diminution : de 29% en 2016 à 25% en 2022. En revanche, en 2022, près de 45% des 80 ans et plus sont BIM.
• La proportion de bénéficiaires du statut affection chronique est en augmentation : de 31% en 2016 à 37% en 2022.
• Près d’une personne âgée de 65 ans et plus sur trois vit seule (ménage unipersonnel). À Bruxelles, c’est près de la moitié.
Indicateurs de recours aux soins :
• La médecine générale est, de loin, privilégiée : plus de neuf aîné∙es sur dix y ont recours au moins une fois par an. Les contacts ambulatoires avec des spécialistes sont également très
fréquents : en 2022, 78% des 65 ans et plus y ont eu recours au moins une fois. Environ 21% de nos aîné∙es font appel aux soins infirmiers à domicile. Le recours aux médicaments ambulatoires est important : 86% des personnes âgées de 65 ans et plus consomment au moins 180 DDD par an.
• Une personne âgée de 65 ans et plus sur cinq a été hospitalisée en 2022 ou a fait appel aux urgences. Une personne sur quatre a eu au moins une hospitalisation de jour.
• Les centres de soins de jour sont peu utilisés en 2022 (0,5% des 65 ans et plus ; 1,1% des 85 ans et plus). Les centres de court séjour en maison de repos un peu plus : 1,3% des 65 ans et plus y ont eu recours au moins une journée en 2022 (4,3% des 85 ans et plus). Les personnes âgées séjournant durablement en maison de repos sont plus nombreuses : 7,3% des 65 ans et plus en 2022 (28% des 85 ans et plus).
Derrière ces tendances générales, il y a aussi diverses variations. Bien sûr, il y a des effets d’âge, comme on peut s’y attendre. Mais ce qui est davantage frappant, ce sont les effets liés au statut BIM. Les aîné∙es qui sont BIM ont systématiquement des indicateurs de santé plus dégradés. Par exemple, la proportion de décès observés est 2,4 fois plus élevée chez les BIM que chez les non BIM. La prévalence des pathologies chroniques est également plus élevée chez les BIM. Enfin, ces personnes font plus fréquemment appel aux médecins généralistes (mais moins souvent aux médecins spécialistes), aux soins infirmiers à domicile, aux urgences hospitalières, sont plus fréquemment inscrites en maison médicale, sont plus fréquemment admises à l’hôpital, résident plus souvent en maison de repos. On trouve aussi beaucoup de variations régionales. Ainsi les proportions de Bruxellois∙es et Liégeois∙es qui font appel aux médecins généralistes sont plus faibles, mais ceci est compensé par le fait que qu’ils∙elles sont plus fréquemment inscrit∙es en maison médicale. Les aîné∙es de Bruxelles vont plus fréquemment que d’autres aux urgences hospitalières. De leur côté, les aîné∙es du Limbourg et du Hainaut font plus souvent appel aux soins infirmiers à domicile. Le profil des aîné∙es est donc bien diversifié. En tenir compte, ainsi que des situations locales (tant sur le plan social que sur le plan de l’offre de soins) est un véritable défi qui s’adresse à tous les responsables politiques (aussi bien fédéraux que régionaux) et acteurs de terrain. D’ores et déjà, au vu de ce profil, se dessinent des pistes d’action pour l’avenir : continuer à investir dans les soins de première ligne, soutenir les aidants proches, avoir de l’attention pour les plus vulnérables et pour la qualité de vie de nos aîné∙es."Note de contenu : Bibliographie p. 41-43 En ligne : https://cm-mc.bynder.com/m/316866fed32d3c52/original/Sante-Societe-n-9.pdf Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40474
in Santé & Société > 9 (Avril 2024) . - p. 4-43[article] Profil de santé de nos aîné·es [texte imprimé] / Katte Ackaert ; Hervé Avalosse ; Rebekka Verniest . - 2024 . - p. 4-43.
Langues : Français (fre)
in Santé & Société > 9 (Avril 2024) . - p. 4-43
Catégories : TS
Personnes âgées:Personnes âgées -- Santé et hygiène # Personnes âgées:Personnes âgées -- Soins # Recherche quantitative # Vieillissement # Vieillissement :Vieillissement de la populationRésumé : "Telle une antienne, nous entendons continuellement : « la Belgique vieillit ». Mais que devons-nous comprendre par là ? Le fait que le nombre et la proportion de personnes âgées au sein
de la population sont en croissance. Ainsi, les projections démographiques indiquent que le nombre de personnes de 80 ans et plus va doubler d’ici 2050. Pour tout un chacun, vieillir n’est pas forcément une mauvaise nouvelle : avoir la perspective d’une vie longue et épanouissante est plutôt positif. Toutefois, nous n’aurons pas tous et toutes l’opportunité de vieillir en bonne santé : beaucoup de personnes âgées feront face à des problèmes de santé (aigus et/ou chroniques) et de perte d’autonomie. Et comme le nombre de personnes âgées va s’accroître, le recours aux services de santé et d’aide va également s’intensifier. C’est donc à un défi sociétal considérable auquel nous devons faire face. Comment s’y préparer ? D’abord en dressant le profil de santé de nos aîné∙es. Dans quel état de santé sont-ils∙elles ? Dans quelle situation sociale sont-ils∙elles ? À quels soins font-ils∙elles appel ? La MC a déjà publié bien des études sur les soins aux aîné∙es. Mais elles étaient souvent partielles. Avec la présente étude, notre ambition est d’être systématique. Pour la première fois, nous analysons de façon globale le profil des aîné∙es de la MC, soit la population de nos membres ayant 65 ans et plus, au cours de la période 2016 à 2022. Quelques résultats
généraux ci-après.
Indicateurs d’état de santé :
• Les affections cardiovasculaires sont le problème de santé le plus fréquent (62% des 65 ans et plus). Viennent ensuite les problèmes de thrombose (41%), le diabète (18%), des pathologies mentales (13%). Environ un cinquième de nos aîné∙es ne présentent aucune des pathologies examinées dans cette étude.
• La proportion de personnes en soins palliatifs est assez faible : 1,5% pour les 65 ans et plus, 4% pour les 80 ans et plus.
• De l’ordre de 4% des 65 ans et plus (12% pour les 85 ans et plus) décèdent chaque année
Indicateurs de vulnérabilité sociale :
• La proportion de bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) est en diminution : de 29% en 2016 à 25% en 2022. En revanche, en 2022, près de 45% des 80 ans et plus sont BIM.
• La proportion de bénéficiaires du statut affection chronique est en augmentation : de 31% en 2016 à 37% en 2022.
• Près d’une personne âgée de 65 ans et plus sur trois vit seule (ménage unipersonnel). À Bruxelles, c’est près de la moitié.
Indicateurs de recours aux soins :
• La médecine générale est, de loin, privilégiée : plus de neuf aîné∙es sur dix y ont recours au moins une fois par an. Les contacts ambulatoires avec des spécialistes sont également très
fréquents : en 2022, 78% des 65 ans et plus y ont eu recours au moins une fois. Environ 21% de nos aîné∙es font appel aux soins infirmiers à domicile. Le recours aux médicaments ambulatoires est important : 86% des personnes âgées de 65 ans et plus consomment au moins 180 DDD par an.
• Une personne âgée de 65 ans et plus sur cinq a été hospitalisée en 2022 ou a fait appel aux urgences. Une personne sur quatre a eu au moins une hospitalisation de jour.
• Les centres de soins de jour sont peu utilisés en 2022 (0,5% des 65 ans et plus ; 1,1% des 85 ans et plus). Les centres de court séjour en maison de repos un peu plus : 1,3% des 65 ans et plus y ont eu recours au moins une journée en 2022 (4,3% des 85 ans et plus). Les personnes âgées séjournant durablement en maison de repos sont plus nombreuses : 7,3% des 65 ans et plus en 2022 (28% des 85 ans et plus).
Derrière ces tendances générales, il y a aussi diverses variations. Bien sûr, il y a des effets d’âge, comme on peut s’y attendre. Mais ce qui est davantage frappant, ce sont les effets liés au statut BIM. Les aîné∙es qui sont BIM ont systématiquement des indicateurs de santé plus dégradés. Par exemple, la proportion de décès observés est 2,4 fois plus élevée chez les BIM que chez les non BIM. La prévalence des pathologies chroniques est également plus élevée chez les BIM. Enfin, ces personnes font plus fréquemment appel aux médecins généralistes (mais moins souvent aux médecins spécialistes), aux soins infirmiers à domicile, aux urgences hospitalières, sont plus fréquemment inscrites en maison médicale, sont plus fréquemment admises à l’hôpital, résident plus souvent en maison de repos. On trouve aussi beaucoup de variations régionales. Ainsi les proportions de Bruxellois∙es et Liégeois∙es qui font appel aux médecins généralistes sont plus faibles, mais ceci est compensé par le fait que qu’ils∙elles sont plus fréquemment inscrit∙es en maison médicale. Les aîné∙es de Bruxelles vont plus fréquemment que d’autres aux urgences hospitalières. De leur côté, les aîné∙es du Limbourg et du Hainaut font plus souvent appel aux soins infirmiers à domicile. Le profil des aîné∙es est donc bien diversifié. En tenir compte, ainsi que des situations locales (tant sur le plan social que sur le plan de l’offre de soins) est un véritable défi qui s’adresse à tous les responsables politiques (aussi bien fédéraux que régionaux) et acteurs de terrain. D’ores et déjà, au vu de ce profil, se dessinent des pistes d’action pour l’avenir : continuer à investir dans les soins de première ligne, soutenir les aidants proches, avoir de l’attention pour les plus vulnérables et pour la qualité de vie de nos aîné∙es."Note de contenu : Bibliographie p. 41-43 En ligne : https://cm-mc.bynder.com/m/316866fed32d3c52/original/Sante-Societe-n-9.pdf Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40474 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité PER SSO 9 (2024) Périodique Centre de documentation HELHa Cardijn LLN Salle de lecture (Périodiques) Disponible Budget des soins de santé 2024 : « d’abord le contenu » / Saskia Mahieu in Santé & Société, 9 (Avril 2024)

Titre : Budget des soins de santé 2024 : « d’abord le contenu » Type de document : texte imprimé Auteurs : Saskia Mahieu Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 44-55 Langues : Français (fre) Catégories : TS
Mutualité # Soins médicaux # Soins médicaux:Soins médicaux -- Coût # Soins médicaux:Soins médicaux -- FinancementRésumé : "C’est au travers d’une coconstruction avec l’ensemble des secteurs des soins de santé et beaucoup moins via des négociations bilatérales secteur par secteur que les travaux autour du budget des soins de santé 2024 ont été menés. Les prestataires de soins et les organismes assureurs se sont réunis pour clarifier les montants disponibles pour de nouvelles initiatives budgétaires et réfléchir collectivement à une répartition de ces moyens. Dans la pratique, les médecins, spécialistes et généralistes, les infirmièr·es, les dentistes, les sage-femmes, les représentants des hôpitaux, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychologues et les autres prestataires ont écouté les besoins prioritaires de chaque secteur, ainsi que ceux identifiés en termes d’accessibilité par les mutuelles. L’objectif était de répartir une enveloppe commune et de prendre en compte les besoins spécifiques des secteurs financés par l’assurance obligatoire soins de santé tout en veillant à ce que suffisamment d’accessibilité aux soins soit garantie. C’est un vrai exercice d’équilibriste au centre d’intérêts très divergents et pour lequel les travaux de la future Commission pour les objectifs de soins de santé sont attendus. Travailler avec des objectifs de soins de santé devrait, de plus en plus, donner un cadre commun et permettre d’arbitrer entre des choix budgétaires. Le cadre financier de l’année 2024 était particulièrement peu clair étant donné les nombreuses modifications apportées en cours d’année 2023 par le gouvernement (entre autres une réduction de la norme de croissance de 2,5% à 2% et des montants qui ne peuvent pas être dépensés). À ce cadre, s’ajoutait l’exercice 'appropriate care', un exercice de réallocation de moyens également demandé au secteur des soins de santé pour générer plus de 'health value'. Sous l’impulsion des mutualités, les prestataires de soins ont décidé, en accord avec ce qui avait été fixé l’année précédente, de redistribuer le budget commun de 100 millions d’euros afin de maintenir autant que possible le taux de conventionnement. Il a été solidairement décidé d’allouer ce budget à certains secteurs prioritaires en termes d’accessibilité, tels que les soins à domicile, l’obstétrique, les soins de maternité, la kinésithérapie, la logopédie et les soins dentaires. Bien que le Conseil général au sein de l’INAMI n’ait pas suivi la proposition du Comité de l’assurance à la lettre, les mutualités ont dans tous les cas démontré que le modèle de concertation entre les mutualités et les prestataires de soins fonctionne et que c’est précisément en période de défis majeurs pour le système de soins de santé et de pénurie budgétaire qu’il est nécessaire d’aborder l’élaboration du budget de manière intersectorielle." Note de contenu : Bibliographie p. 55 En ligne : https://cm-mc.bynder.com/m/316866fed32d3c52/original/Sante-Societe-n-9.pdf Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40475
in Santé & Société > 9 (Avril 2024) . - p. 44-55[article] Budget des soins de santé 2024 : « d’abord le contenu » [texte imprimé] / Saskia Mahieu . - 2024 . - p. 44-55.
Langues : Français (fre)
in Santé & Société > 9 (Avril 2024) . - p. 44-55
Catégories : TS
Mutualité # Soins médicaux # Soins médicaux:Soins médicaux -- Coût # Soins médicaux:Soins médicaux -- FinancementRésumé : "C’est au travers d’une coconstruction avec l’ensemble des secteurs des soins de santé et beaucoup moins via des négociations bilatérales secteur par secteur que les travaux autour du budget des soins de santé 2024 ont été menés. Les prestataires de soins et les organismes assureurs se sont réunis pour clarifier les montants disponibles pour de nouvelles initiatives budgétaires et réfléchir collectivement à une répartition de ces moyens. Dans la pratique, les médecins, spécialistes et généralistes, les infirmièr·es, les dentistes, les sage-femmes, les représentants des hôpitaux, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychologues et les autres prestataires ont écouté les besoins prioritaires de chaque secteur, ainsi que ceux identifiés en termes d’accessibilité par les mutuelles. L’objectif était de répartir une enveloppe commune et de prendre en compte les besoins spécifiques des secteurs financés par l’assurance obligatoire soins de santé tout en veillant à ce que suffisamment d’accessibilité aux soins soit garantie. C’est un vrai exercice d’équilibriste au centre d’intérêts très divergents et pour lequel les travaux de la future Commission pour les objectifs de soins de santé sont attendus. Travailler avec des objectifs de soins de santé devrait, de plus en plus, donner un cadre commun et permettre d’arbitrer entre des choix budgétaires. Le cadre financier de l’année 2024 était particulièrement peu clair étant donné les nombreuses modifications apportées en cours d’année 2023 par le gouvernement (entre autres une réduction de la norme de croissance de 2,5% à 2% et des montants qui ne peuvent pas être dépensés). À ce cadre, s’ajoutait l’exercice 'appropriate care', un exercice de réallocation de moyens également demandé au secteur des soins de santé pour générer plus de 'health value'. Sous l’impulsion des mutualités, les prestataires de soins ont décidé, en accord avec ce qui avait été fixé l’année précédente, de redistribuer le budget commun de 100 millions d’euros afin de maintenir autant que possible le taux de conventionnement. Il a été solidairement décidé d’allouer ce budget à certains secteurs prioritaires en termes d’accessibilité, tels que les soins à domicile, l’obstétrique, les soins de maternité, la kinésithérapie, la logopédie et les soins dentaires. Bien que le Conseil général au sein de l’INAMI n’ait pas suivi la proposition du Comité de l’assurance à la lettre, les mutualités ont dans tous les cas démontré que le modèle de concertation entre les mutualités et les prestataires de soins fonctionne et que c’est précisément en période de défis majeurs pour le système de soins de santé et de pénurie budgétaire qu’il est nécessaire d’aborder l’élaboration du budget de manière intersectorielle." Note de contenu : Bibliographie p. 55 En ligne : https://cm-mc.bynder.com/m/316866fed32d3c52/original/Sante-Societe-n-9.pdf Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40475 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité PER SSO 9 (2024) Périodique Centre de documentation HELHa Cardijn LLN Salle de lecture (Périodiques) Disponible Les changements environnementaux mondiaux et leurs effets sur la santé : Résumé du chapitre 2 du rapport Planetary Health, an emerging field to be developed (La santé planétaire, un domaine émergent à développer) / Ann Morissens in Santé & Société, 9 (Avril 2024)

Titre : Les changements environnementaux mondiaux et leurs effets sur la santé : Résumé du chapitre 2 du rapport Planetary Health, an emerging field to be developed (La santé planétaire, un domaine émergent à développer) Type de document : texte imprimé Auteurs : Ann Morissens Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 56-61 Langues : Français (fre) Catégories : TS
Biodiversité # Maladies de l'environnement # Réchauffement de la Terre # Santé # Santé et hygièneRésumé : "Notre planète et notre santé sont confrontées à de nombreux défis tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et le changement environnemental mondial. Ces défis représentent un enjeu considérable pour la santé des populations du monde entier. Certains des effets directs sur la santé sont connus, mais nous ignorons encore beaucoup de choses concernant l’impact des changements environnementaux sur la santé humaine. Dans ce rapport, l’Académie royale néerlandaise des arts et des sciences (KNAW) présente son point de vue sur le domaine de recherche Planetary health (santé planétaire) et identifie un certain nombre de lacunes dans les connaissances relatives à la santé. Ce lu pour vous se concentre sur l’impact des changements environnementaux mondiaux sur la santé humaine et les preuves scientifiques déjà établies à ce sujet (chapitre 2 du rapport). Les autres domaines de recherche couverts par le rapport comprennent le développement de possibilités d’atténuation et d’adaptation efficaces, la promotion de la mise en œuvre de ces options ainsi que les données et les méthodes pour la recherche sur la santé planétaire." Note de contenu : Bibliographie p. 61 En ligne : https://cm-mc.bynder.com/m/316866fed32d3c52/original/Sante-Societe-n-9.pdf Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40476
in Santé & Société > 9 (Avril 2024) . - p. 56-61[article] Les changements environnementaux mondiaux et leurs effets sur la santé : Résumé du chapitre 2 du rapport Planetary Health, an emerging field to be developed (La santé planétaire, un domaine émergent à développer) [texte imprimé] / Ann Morissens . - 2024 . - p. 56-61.
Langues : Français (fre)
in Santé & Société > 9 (Avril 2024) . - p. 56-61
Catégories : TS
Biodiversité # Maladies de l'environnement # Réchauffement de la Terre # Santé # Santé et hygièneRésumé : "Notre planète et notre santé sont confrontées à de nombreux défis tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et le changement environnemental mondial. Ces défis représentent un enjeu considérable pour la santé des populations du monde entier. Certains des effets directs sur la santé sont connus, mais nous ignorons encore beaucoup de choses concernant l’impact des changements environnementaux sur la santé humaine. Dans ce rapport, l’Académie royale néerlandaise des arts et des sciences (KNAW) présente son point de vue sur le domaine de recherche Planetary health (santé planétaire) et identifie un certain nombre de lacunes dans les connaissances relatives à la santé. Ce lu pour vous se concentre sur l’impact des changements environnementaux mondiaux sur la santé humaine et les preuves scientifiques déjà établies à ce sujet (chapitre 2 du rapport). Les autres domaines de recherche couverts par le rapport comprennent le développement de possibilités d’atténuation et d’adaptation efficaces, la promotion de la mise en œuvre de ces options ainsi que les données et les méthodes pour la recherche sur la santé planétaire." Note de contenu : Bibliographie p. 61 En ligne : https://cm-mc.bynder.com/m/316866fed32d3c52/original/Sante-Societe-n-9.pdf Permalink : http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40476 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité PER SSO 9 (2024) Périodique Centre de documentation HELHa Cardijn LLN Salle de lecture (Périodiques) Disponible