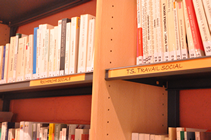[article]
| Titre : |
L'apport du socioculturel à la cohésion sociale au regard de la longue histoire des centres sociaux |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Jacques Eloy |
| Année de publication : |
2015 |
| Article en page(s) : |
p. 37-45 |
| Note générale : |
Issu du dossier "Arts, culture et cohésion sociale" |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
Cardijn
Cohésion sociale # Socioculturel
|
| Résumé : |
"Le discours et les différents dispositifs socioculturels, nés en France à la fin des années 1950, sont particulièrement actifs pendant les deux décennies 1960 et 1970. Les centres sociaux sont à la fois objets et acteurs de cette nouvelle utopie, recomposant l’action sociale et l’éducation populaire préétablies. Se voulant, dès le début du XXe siècle, acteurs de réconciliation sociale, ils avaient, à l’époque, inclus dans leurs pratiques des actions de développement culturel et artistiques. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils s’étaient inscrits dans la « solidarisation » nationale, instituée par la Sécurité sociale, en devenant quasi exclusivement acteurs sociaux, en lien principal avec les caisses d’Allocations familiales. La critique intellectuelle, dès les années 1970 et l’extension d’une crise économique systémique, à partir des années 1980, remettent en cause la capacité « cohésive » du socioculturel. Les centres sociaux, « territoriaux » par vocation et par mandat, conçoivent désormais leurs actions sociales, socioculturelles et culturelles comme relevant d’une dynamique de développement social local, ayant la capacité de rétablir localement une solidarité sociale." |
| En ligne : |
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=INSO_190_0037 |
| Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21973 |
in Informations sociales > 190 (Juillet - Août 2015) . - p. 37-45
[article] L'apport du socioculturel à la cohésion sociale au regard de la longue histoire des centres sociaux [texte imprimé] / Jacques Eloy . - 2015 . - p. 37-45. Issu du dossier "Arts, culture et cohésion sociale" Langues : Français ( fre) in Informations sociales > 190 (Juillet - Août 2015) . - p. 37-45
| Catégories : |
Cardijn
Cohésion sociale # Socioculturel
|
| Résumé : |
"Le discours et les différents dispositifs socioculturels, nés en France à la fin des années 1950, sont particulièrement actifs pendant les deux décennies 1960 et 1970. Les centres sociaux sont à la fois objets et acteurs de cette nouvelle utopie, recomposant l’action sociale et l’éducation populaire préétablies. Se voulant, dès le début du XXe siècle, acteurs de réconciliation sociale, ils avaient, à l’époque, inclus dans leurs pratiques des actions de développement culturel et artistiques. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils s’étaient inscrits dans la « solidarisation » nationale, instituée par la Sécurité sociale, en devenant quasi exclusivement acteurs sociaux, en lien principal avec les caisses d’Allocations familiales. La critique intellectuelle, dès les années 1970 et l’extension d’une crise économique systémique, à partir des années 1980, remettent en cause la capacité « cohésive » du socioculturel. Les centres sociaux, « territoriaux » par vocation et par mandat, conçoivent désormais leurs actions sociales, socioculturelles et culturelles comme relevant d’une dynamique de développement social local, ayant la capacité de rétablir localement une solidarité sociale." |
| En ligne : |
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=INSO_190_0037 |
| Permalink : |
http://cdocs.helha.be/pmblln/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=21973 |
|  |